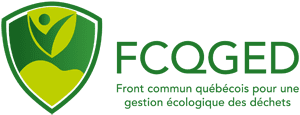Le 6 août 2025, RECYC-QUÉBEC a dévoilé la version complète de son Bilan 2023 de la gestion des matières résiduelles au Québec. Produit tous les deux ans, le Bilan permet de brosser un portrait des activités de gestion des matières résiduelles (GMR) en se penchant sur une dizaine de secteurs clés. L’analyse des résultats du Bilan 2023, lorsqu’elle est mise en perspective avec ceux de 2021, permet de dégager plusieurs tendances offrant une meilleure compréhension de l’évolution de la GMR au Québec.
Les résultats du Bilan sont organisés en une dizaine de sections distinctes. Sans résumer l’ensemble des statistiques exposées dans le document, nous croyons qu’il est pertinent de relever quelques faits saillants.
Performance de la collecte sélective
En commençant avec la collecte sélective, on note, à très grande échelle, une stagnation relative, voire une légère amélioration du système. Alors qu’en 2021, 47 % des matières recyclables étaient générées par les ménages et par les industries, commerces et institutions (ICI) assimilables, cette valeur s’élevait plutôt à 48 % en 2023. Ce résultat en apparence similaire cache tout de même une évolution plus importante lorsqu’on y regarde de plus près.
D’un côté, la proportion de matières recyclables récupérées auprès des ménages et des ICI assimilables a augmenté de 4 %. De l’autre, la proportion de matières acheminées par les centres de tri vers des conditionneurs et recycleurs a diminué de 4 %. On peut présumer que l’augmentation des matières récupérées est au moins partiellement attribuable aux efforts d’information, de sensibilisation et d’éducation auprès de la population. Quant à la diminution des matières acheminées vers un recycleur ou un conditionneur (qui équivaut à une augmentation des rejets), RECYC-QUÉBEC l’attribue à un rehaussement des exigences pour les matières sortant des centres de tri.
Dans l’ensemble, RECYC-QUÉBEC juge que la stagnation de la performance globale du système sous la barre des 50 % est le fruit de ses limites inhérentes. On notera toutefois que le Bilan de 2023 est le dernier qui sera produit sous ce même système, étant donné que la modernisation de la collecte sélective est entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Performance du système de consigne
Un autre mode de récupération qui méritera d’être surveillé lors du prochain bilan est le système de consigne. Comme le système de collecte sélective, celui-ci est en phase de modernisation avec un changement de type de gestion et l’élargissement des contenants visés. Les contenants de plastique ont récemment été ajoutés et l’élargissement aux contenants de boisson en verre et des multicouches est prévu pour 2027.
Entre-temps, on assiste à un plafonnement de la performance du système de consigne. En effet, on constate une légère diminution des taux de récupération des contenants consignés comparativement à 2021. Ce déclin relatif se chiffre à moins de 1 % en considérant le poids et à environ 2,5 % en termes de nombre de contenants récupérés. Cet écart s’explique d’ailleurs en partie par une évolution des matières privilégiées pour les contenants de boisson, l’aluminium et le plastique ayant gagné en popularité au profit du verre.
La baisse de certains indicateurs de performance du système de consigne est préoccupante, surtout lorsqu’on considère que les taux de récupération des contenants consignés, pris en tonnes, enregistrent un lent déclin depuis 2015. Il est difficile de cibler la cause de cette baisse de performance, mais on peut s’attendre à de nouvelles variations au cours des prochains bilans. Alors que l’augmentation des montants de consignes de 2023 pourrait augmenter la performance du système dans le bilan de 2025, l’intégration de nouvelles catégories de contenants en 2027 pourrait bouleverser les habitudes des citoyens et entraîner une baisse temporaire du taux de récupération.
D’ailleurs, la tendance récente au niveau de la performance de la consigne ne doit pas effacer le fait qu’il s’agit d’un mode de récupération globalement efficace. Le Bilan 2021 de RECYC-QUÉBEC rapportait d’ailleurs qu’une enquête auprès de la population révélait une forte adhésion au système de consigne québécois.
Une amélioration dans la prise en charge des matières organiques
Les résultats de la valorisation des matières organiques sont encourageants. Globalement, 64 % des matières organiques ont été valorisées, ce qui est au-dessus de la cible gouvernementale de 60 % pour 2023. L’amélioration de cette performance moyenne est principalement due à l’augmentation des taux de valorisation du secteur municipal, passant de 48 % en 2021 à 57 % en 2023, et des ICI, passant de 8 % en 2021 à 33 % en 2023. Du côté municipal, c’est surtout le déploiement progressif des systèmes de récupération des matières organiques qui a permis l’augmentation des taux. Pour ce qui est des ICI, on associe l’amélioration de la performance à la mise en service de nouvelles installations de biométhanisation.
Deux anomalies sont toutefois relevées dans le Bilan. Premièrement, l’amélioration de la valorisation des matières organiques dans le secteur municipal est issue d’un maintien des quantités absolues de matières recyclées entre 2021 et 2023 (1 002 000 tonnes pour 2021 et 1 073 000 tonnes pour 2023), mais à une diminution de près de 244 000 tonnes des résidus verts et alimentaires générés. RECYC-QUÉBEC avance l’hypothèse qu’une baisse du gaspillage alimentaire des ménages et une adhésion renforcée au compostage domestique pourraient expliquer ce phénomène. Néanmoins, nous croyons qu’il serait étonnant de voir une progression aussi prononcée à ce niveau en seulement deux ans.
Deuxièmement, un taux de recyclage de 100 % a été rapporté par les industries de transformation alimentaires ayant participé au Bilan. Cette donnée contribue à rehausser la performance globale de la province en matière de taux de valorisation de la matière organique. RECYC-QUÉBEC note que ce taux est fort probablement inexact en raison d’une sous-estimation des quantités générées par les entreprises de ce secteur.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’amélioration du détournement des matières organiques de l’enfouissement est le principal facteur permettant d’expliquer la diminution de la quantité de matières résiduelles éliminées par habitant comparativement à 2021 (-5 %). Qui plus est, détourner les matières organiques de l’élimination devrait continuer d’être une priorité. Tout comme la perte d’autres matières recyclables, l’élimination des matières organiques constitue un gaspillage de ressources. En plus de cet élément commun, lorsqu’elles sont éliminées par enfouissement, les matières organiques génèrent du méthane qui doit être géré par les lieux d’enfouissement afin d’atténuer son potentiel de réchauffement élevé. Ainsi, il y a un avantage double à miser sur la valorisation de la matière organique.
La question du verre
Les résultats du Bilan entourant le verre issu de la collecte sélective sont à la fois encourageants et surprenants. La bonne nouvelle est que, bien que 53 % du verre sortant des centres de tri soit toujours envoyé vers les sites d’enfouissement, la proportion de matières connaissant un tel sort a diminué de 17 %. Cette diminution s’est traduite par une augmentation de la quantité de matières acheminées vers des recycleurs et conditionneurs. RECYC-QUÉBEC associe cette situation à l’entrée en vigueur d’une redevance partielle à l’élimination pour les matériaux utilisés comme recouvrement dans les lieux d’enfouissement, usage principal auquel est voué le verre des centres de tri dans ces installations.
Le détournement du verre sortant des centres de tri des sites d’enfouissement ne peut être vu que d’un bon œil. La valorisation de cette matière à des fins de recouvrement ou de construction de chemin d’accès n’est pas si loin de l’élimination en termes de respect de la hiérarchie des 3RV-E. Néanmoins, il nous semble qu’il est trop tôt pour crier victoire dans le dossier du verre. D’une part, il convient de rappeler que, malgré l’amélioration observée depuis 2021, c’est encore la majorité du verre sortant des centres de tri qui est acheminé vers des sites d’enfouissement. À cela, il faut ajouter une certaine proportion (14 %) du verre reçu par les recycleurs et les conditionneurs qui est par la suite rejeté par ces derniers.
D’autre part, nous jugeons qu’il est également utile de se pencher sur l’usage qui est fait du verre qui est détourné des sites d’enfouissement vers les recycleurs et conditionneurs. Le Bilan 2023 mentionne que les principaux usages du verre recyclé sont « la refonte en bouteilles, le sable de projection et les matériaux de filtration, les microbilles utilisées dans l’industrie du transport et pour le polissage des métaux, le verre micronisé pour des usages variés, la production de laine isolante, ainsi que l’ajout cimentaire pour les produits réfractaires. » Or, il n’est pas spécifié quelle proportion est associée à chaque utilisation et aucune distinction n’est faite entre les gisements dont le verre recyclé est issu. On sait toutefois que la valeur du verre de la collecte sélective sur le marché des matières recyclables est encore négative, ce qui implique que la qualité moyenne du gisement est encore très basse. En ce sens, il semble probable qu’une part importante du verre détourné des sites d’enfouissement ait été valorisée via du sable de projection ou des ajouts cimentaires. Ces usages ne sont pas comparables, au sens de la hiérarchie des 3RV-E, au recyclage du verre sous forme de verre, qui est l’option la plus souhaitable.
Enjeux entourant le plastique
Certaines tendances ont retenu notre attention concernant les matières plastiques issues de la collecte sélective. La part des plastiques a augmenté dans le total des matières sortantes des centres de tri. Alors qu’ils représentaient 7 % du total de 2021, ils comptaient plutôt pour 10 % des matières sortantes en 2023. La qualité moyenne de ces matières sortantes semble toutefois avoir diminué. On remarque d’abord une diminution de l’indice du prix des matières plastiques entre 2021 et 2023. Ce phénomène peut être attribué à de nombreuses causes, mais la diminution de la qualité du gisement pourrait être une explication. Un autre indicateur mérite d’être considéré à ce niveau ; le taux de contamination des ballots de contenants et d’emballages en plastique reçus par les conditionneurs et recycleurs de la province variait entre 1 % et 50 % dans le Bilan 2023. Or, pour 2021, les taux de contamination pour les mêmes gisements s’échelonnaient plutôt entre 1 % et 35 %. Cette évolution paraît également suggérer une diminution de la qualité des plastiques issus de la collecte sélective, puisque la majorité des matières reçues par les conditionneurs et recycleurs québécois étaient issues de cette source.
Un second point a retenu notre attention. La valorisation énergétique semble prendre de plus en plus de place dans la gestion des plastiques issus de la collecte sélective. Effectivement, on note une augmentation marquée des plastiques sortants des centres de tri étant acheminés à cette filière. De 5 % du total en 2021, c’était plutôt 17 % des plastiques sortants qui étaient valorisés de cette manière en 2023, une augmentation de 12 % en deux ans.
Cette tendance nous semble préoccupante. Il est d’abord important de rappeler que, selon la hiérarchie des 3RV-E, le recyclage devrait systématiquement prévaloir sur toute forme de valorisation. Il est donc nécessaire d’éviter que ces deux filières compétitionnent pour un accès au même gisement de matières. Il y a donc de quoi s’inquiéter de voir la valorisation capter une part de plus en plus importante de matières recyclables. De plus, les pratiques de valorisation énergétique ne font toujours pas l’objet d’un encadrement légal au Québec. Aucun barème spécifique ne permet donc d’encadrer et d’atténuer les impacts environnementaux ou sanitaires des procédés employés.
Cela étant dit, il convient tout de même de noter que les plastiques représentent un gisement mineur dans le portrait global des matières acheminées à des filières de valorisation énergétique (environ 1 %). Pris autrement, l’évolution de la situation est regrettable, mais la problématique demeure contenue.
Exacerbation des problématiques liées au textile
La quantité captée par les installations de récupération des textiles a augmenté depuis la période couverte par le Bilan précédent. En considérant uniquement les organisations qui ont participé au Bilan de 2021 et de 2023, cette hausse se chiffre à 9 %. Il y a également eu une évolution de la destination finale des textiles reçus par ces organisations. Toutes proportions gardées, de moins en moins de matières textiles acheminées à des organismes de récupération sont réemployées localement. En fait, la part des textiles ayant été utilisés à cette fin a chuté de 11 %, passant de 40 % en 2021 à 29 % en 2023. Cette diminution du réemploi a été principalement comblée par l’acheminement à des courtiers à des fins d’exportation (de 39 % à 44 % [+5 %]) et par la transformation sur place (de 15 % à 19 % [+4 %]). Ces deux avenues sont moins souhaitables que le réemploi local. D’un côté, l’exportation pose des problèmes importants au niveau de la traçabilité en ce sens qu’on ignore l’usage final d’une matière exportée. De l’autre, la transformation locale de vêtements en chiffons et autres produits d’artisanat est assimilable à du recyclage, voire à du sous-cyclage, une pratique face à laquelle le réemploi devrait avoir la priorité en suivant la hiérarchie des 3RV-E.
En dépit du travail important mené par les organismes de récupération des textiles, la situation globale entourant cette matière est alarmante. Environ 344 000 tonnes de textiles ont été éliminées en 2023, un nombre qui dépasse largement les quantités récupérées rapportées de 38 000 tonnes. RECYC-QUÉBEC note que, depuis 2011, le volume de textiles jetés a augmenté de plus de 114 %. De plus, une augmentation de 18 % a été relevée entre 2019 et 2023 uniquement. Toujours selon RECYC-QUÉBEC, cette hausse vertigineuse de l’élimination des textiles est le résultat de l’avènement de la mode rapide (fast fashion), un phénomène qui prend d’ailleurs aujourd’hui de l’ampleur avec la mode ultra rapide (ultra fast fashion).
Conclusion
Dans l’ensemble, que doit-on retenir du Bilan 2023 de la GMR au Québec ? Malgré certaines lueurs d’espoir, il est clair qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Le principal point positif à souligner est le déploiement de nouvelles collectes et installations de traitement des matières organiques. L’amélioration continue de la performance dans cette filière est le principal facteur expliquant la baisse de la quantité de matières résiduelles éliminées par habitant entre 2021 et 2023, une autre excellente nouvelle.
Malgré ces éléments favorables, plusieurs sections du rapport sont nettement plus mitigées. Des matières comme le verre, les plastiques et les textiles ne semblent pas, en moyenne, suffisamment en voie d’être traitées d’une manière qui respecte la hiérarchie des 3RV-E. De plus, les systèmes de récupération des matières recyclables, comme la collecte sélective et la consigne, ont vu leur performance stagner comparativement au bilan précédent. Ainsi, les réformes en cours visant la modernisation de ces deux structures seront le point marquant à surveiller dans le prochain bilan.