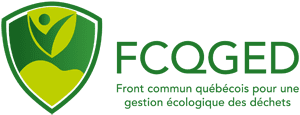Certaines personnes sur mon milieu de travail m’affublent gentiment du sobriquet la mouette. Loin de m’en offusquer, j’utilise cette appellation pour sensibiliser avec amusement mes collègues sur le gaspillage alimentaire. Et oui, je l’avoue, je suis allergique au gaspillage de toute sorte. Je n’embête cependant personne avec ça, il n’y a rien de pire que de vouloir faire la morale aux gens sur leurs habitudes de vie. Aussi, je me rends compte que je ne suis pas le seul qui déteste mettre aux poubelles ce qui peut encore être utile ou bon à manger. Pas toujours facile toutefois d’être une mouette dans ce monde de consommer-jeter.
Bon, avant qu’on me reprenne, la mouette en question que je suis, est un fait un goéland à bec cerclé, l’oiseau qui fréquente nos dépotoirs. Bon, voilà pour les amoureux de la faune en général et les ornithologues en particulier. Moi aussi je préfère mouette; c’est plus parlant, voire même plus sympathique. Fin de la parenthèse.
Oui donc, aujourd’hui nous ne consommons plus comme nous le faisions avant. Globalement, le Québec consomme aujourd’hui quelque 271 millions de tonnes de ressources annuellement. Ça représente environ 30 tonnes par année, par personne. En quelques décennies, nos rapports à la consommation ont radicalement changé. Naguère, c’était davantage l’aspect utilitaire qui déterminait majoritairement le choix de nos achats, pas la compulsion ou l’impulsion, pas non plus notre statut social qui est maintenant souvent déterminé par nos possessions.
Il n’y a pas si longtemps, les biens de consommation étaient aussi perçus différemment. Nous achetions un électroménager, un meuble, un bibelot en sachant qu’ils allaient faire partie de notre environnement immédiat et de nos vies pendant des années. Ce n’était pas de la frugalité, mais plutôt une fidélité réciproque qui se développait; tu m’es utile, je te garde et je prends soin de toi. Comme nos attentes fonctionnelles et pratiques étaient comblées, nous ne ressentions pas le besoin de tout remplacer, tout le temps. La résilience et l’autonomie n’étaient pas des objectifs à atteindre, elles étaient partie intégrante de nos vies.
L’école, la famille ou la société en général, nous apprenaient, il n’y a pas si longtemps que ça encore, la valeur intrinsèque des choses. On ne se posait pas la question si une chemise devait être recousue, une chaussette reprisée ou un grille-pain réparé. Ça allait de soi. Il existait un certain savoir-faire au sein de la communauté, même au sein d’une même famille. Il existait des métiers liés à la réparation, – les plus vieux se souviendront du réparateur Maytag – on faisait réparer nos téléviseurs, nos réfrigérateurs… Il y avait même des cours d’économie familiale qui enseignaient aux jeunes élèves, les rudiments d’une saine gestion d’un foyer.
Même en alimentation, les aliments ultra-transformés n’existaient pas, l’individualisation des portions avec leur lot d’emballages qui les accompagnent non plus.
On produisait aussi beaucoup moins de déchets domestiques. Ce qui devait être éliminé était vraiment le déchet ultime. Et oui, le déchet ultime n’est pas une vision de l’esprit, il a bel et bien existé !
Avec le développement de la société de consommation et l’accroissement de notre pouvoir d’achat qui vient avec, des savoir-faire se perdent, notre résilience en a pris un coup, de même que notre faculté à développer ou à maintenir une certaine autonomie dans nos vies de tous les jours.
Comme le mentionne Boucar Diouf, l’être humain a une propension naturelle à opter pour la loi du moindre effort; la technologie nous a rendus paresseux. Maintenant, ce serait l’intelligence artificielle qui s’en prendrait à ce qui se passe entre nos deux oreilles.
Personnellement, des fois je me demande si cette hausse de notre pouvoir d’achat est une bonne chose. Il est maintenant acquis que le bien-être de gens se calcule en fonction de ce qu’ils sont capables de se procurer. Il s’agit d’un leurre selon moi. Oui, bien sûr, il y a un minimum vital dont nous avons besoin, mais le reste ? On veut nous faire croire que la consommation nous rend heureux, alors que les ménages québécois étaient étouffés par un taux d’endettement de 175 % l’an dernier et que près du tiers avait de la difficulté à rembourser leurs dettes?
Parfois, je crois que la vraie richesse s’exprime dans notre volonté à refuser d’acheter un bien dont nous n’avons pas vraiment besoin, mais dont l’acquisition contribuerait à maintenir un certain statut social. Un peu comme l’a été la thématique de la Semaine québécoise de réduction des déchets cette année : J’en ai assez. J’en ai assez pour refuser d’acheter.
Nous perdons des savoir-faire certains, notre capacité de résilience s’amenuise, nous devenons de plus en plus dépendants de notre consommation et de ce qu’elle représente maintenant pour nous. Avec tout ça, je me demande si notre pouvoir d’achat ou notre liberté économique ne nous rend pas au contraire plus dépendants, comme si nous étions dans des sables mouvants dans lesquels nous débattre ne ferait qu’en augmenter leur emprise sur nous ?
Un bel exemple de cette réflexion est le débat entourant l’agrandissement du port de Montréal à Contrecoeur. Sans parler de ses impacts environnementaux par la destruction de milieux humides ou de l’habitat d’une espèce reconnue comme en voie de disparition par le gouvernement fédéral lui-même, ce projet illustre à quel point le sens commun peut être affecté par des impératifs de consommation.
Alors que ce projet a été décrété comme en étant un d’urgence nationale pouvant bénéficier d’un processus réglementaire accéléré dans le but notamment de développer l’autonomie économique du pays, l’agrandissement du port à Contrecoeur ne fera au contraire, qu’accroître notre dépendance aux produits fabriqués à l’étranger en augmentant considérablement leur importation et leur accès au marché canadien.
On veut éteindre le feu par le feu.
On oublie trop souvent que les meilleures solutions sont les plus simples, mais qu’il faut prendre une certaine distance pour les voir. Pour ça, les mouettes sont avantagées…
Éditorial paru dans l’infolettre d’octobre 2025